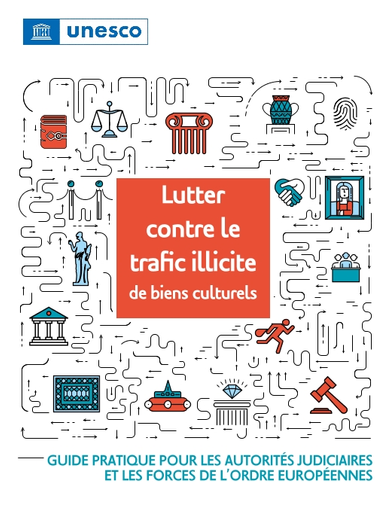Actualités

Culture
8 mars : “Journée internationale des femmes” – Les échasseuses, symbole d’évolution

Culture
Irrigation traditionnelle à Cierreux – Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité

Culture
Carnaval de Binche : 20 ans de reconnaissance au patrimoine immatériel de l’UNESCO – entre tradition et modernité, l’enjeu de l’égalité

Culture
Spa sur la liste du patrimoine mondial les «Grandes Villes d’Eaux d’Europe»

Culture
Reconnaissance des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Culture
Art de la construction en pierre sèche : la Belgique candidate

Culture
La Maison des patrimoines UNESCO à Mons

Culture